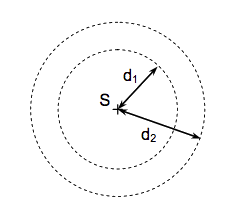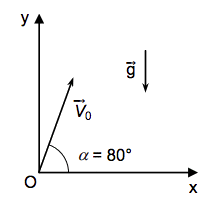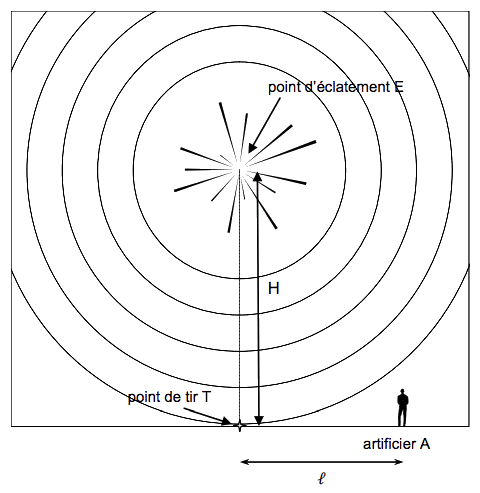Carnet de bac
Annales
Son et lumière |
BAC |
| Métropole 2017 - Exercice 2 -11 points |
|
Pour obtenir un feu d'artifice qui produit son, lumière et fumée, on procède à l’éclatement d’une pièce pyrotechnique. Bien que produisant des effets différents, toutes ces pièces sont conçues selon le même principe. Un dispositif permet de projeter la pièce pyrotechnique vers le haut. Une fois que ce projectile a atteint la hauteur prévue par l’artificier, il éclate, créant l’effet « son et lumière » souhaité. Le but de cet exercice est d’étudier la couleur observée, la trajectoire du projectile et le son émis. Les caractéristiques de deux pièces pyrotechniques nommées « crackling R100 » et « marron d’air »
sont consignées dans le tableau ci-dessous :
Domaines de longueur d’onde de la lumière visible :
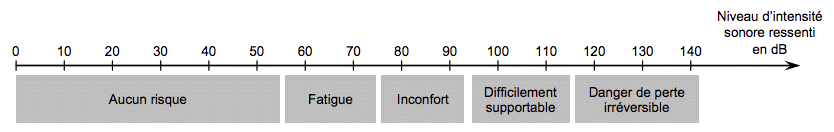
1. Tout en couleur
Les feux d’artifice émettent de la lumière. Les phénomènes mis en jeu sont notamment l’incandescence et l’émission atomique. Il y a tout d’abord l’incandescence des particules d’oxyde métallique, formées lors de la combustion, qui va du « blanc rouge » (aux alentours de 1 000 °C) jusqu’au blanc éblouissant (vers 3 000 °C). Pour l’émission atomique, les électrons de l’atome sont excités thermiquement, ce qui leur permet de passer du niveau d’énergie fondamental à un niveau d’énergie supérieur ; au cours de leur retour vers le niveau d’énergie fondamental, l’énergie qu’ils avaient absorbée est émise sous forme de photons dont la longueur d’onde est caractéristique de l’atome.
D’après Ambafrance
1.1. Le texte fait référence à deux processus d’émission de lumière. Citer chacun de ces processus et préciser, dans chaque cas, si le spectre de la lumière émise est un spectre de raies ou un spectre continu. Le « crackling R100 » est principalement composé de strontium. Les photons émis par le strontium sont responsables de la couleur perçue lors de l’éclatement du « crackling R100 ». Le tableau ci-dessous regroupe les énergies des photons émis par le strontium :
On s’intéresse au mouvement de la pièce pyrotechnique jusqu’à son éclatement dans un référentiel terrestre supposé galiléen muni d’un repère (Ox,Oy). On étudie le mouvement d’un point M de la pièce « crackling R100 ». On prend l’instant du lancement comme origine des temps t = 0 s.
À cet instant, le vecteur vitesse initiale \(\displaystyle\mathrm { \overrightarrow{V}_0 }\) de M fait un angle α = 80° par rapport à l’horizontal (schéma ci-contre).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||