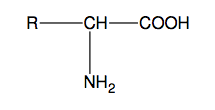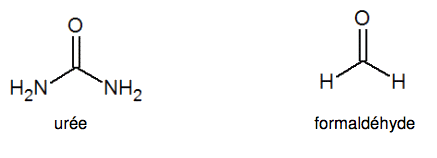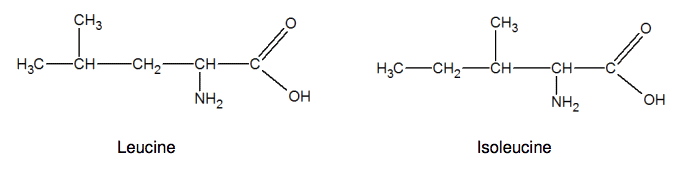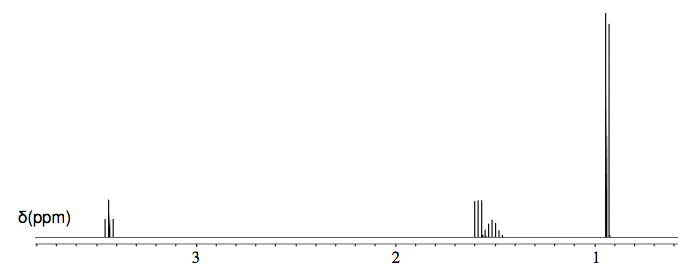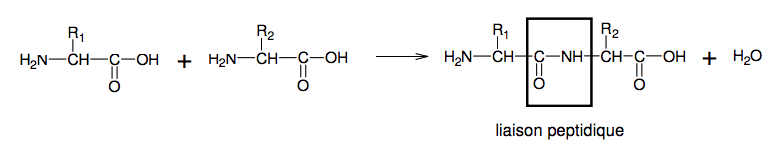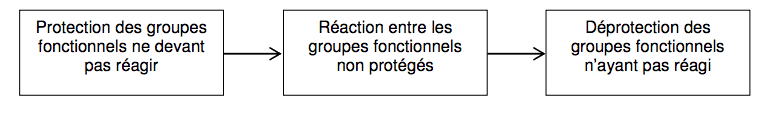Carnet de bac
Annales
A la recherche des molécules de la vie |
|
| Asie 2014 - Exercice 2 - 8 points |
|
Document 1
L'origine des molécules prébiotiques dont l'évolution chimique aurait conduit aux polymères aujourd'hui caractéristiques de la vie, comme les polynucléotides et les protéines, n'est pas connue. Diverses hypothèses ont été formulées. Les premières molécules organiques auraient pu se former sur la Terre par réactions chimiques entre certains constituants de l'atmosphère primitive dissous dans l'eau. Diverses expériences ont en effet montré la possibilité de synthèse de constituants organiques à partir des composants de l'atmosphère primitive. Les premières molécules organiques auraient pu aussi se former au fond des océans au niveau des sources hydrothermales où on a en effet montré expérimentalement la possibilité de synthèse de substances organiques à partir de composés soufrés et d'oxydes de carbone. Enfin, elles auraient pu provenir de l'espace car on a identifié divers précurseurs organiques, notamment des acides aminés, dans des météorites, comètes, etc.
|
|
Document 2
Ce genre de molécules organiques avait été découvert dans la météorite tombée près de la petite ville de Murchison en Australie en 1969. Dans cette chondrite carbonée, les cosmochimistes de l’époque et leurs successeurs ont dénombré plus de 70 acides aminés. Ils y ont ainsi découvert, sous forme de traces, l'alanine, la glycine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la proline, l'acide aspartique et l'acide glutamique, molécules toutes précurseurs pour former les diverses protéines des êtres vivants terrestres. Bien mieux, des purines et des pyrimidines y ont également été trouvées. Or ces molécules sont les bases azotées précurseurs de l'ADN et de l'ARN qui constituent le matériel génétique de tous les êtres vivants que porte la Terre. Grâce à la technique de spectrométrie de masse, Philippe Schmitt-Kopplin, du Helmholtz Centre de Munich, a détecté plus de 14 000 molécules organiques différentes au sein de la célèbre météorite. Selon les chercheurs, ces analyses impliqueraient que cette roche abriterait en réalité des millions de molécules organiques différentes.
D’après Futura science |
|
Document 3
Entre les étoiles, l'espace est extraordinairement froid. Pourtant, les scientifiques ont découvert il y a un demi-siècle que des réactions chimiques d'une étonnante complexité y ont cours : les briques élémentaires du vivant y sont façonnées. Comment est-ce possible? Louis d'Hendecourt, de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) explique comment les grains, sorte de paillettes faites de carbone et de silicate, jouent un rôle essentiel de catalyseur. Selon les résultats de ses dernières recherches, l'une des conditions sine qua non au développement de la vie, la chiralité, résulte aussi de processus à
l'œuvre entre les étoiles. Ce n'est pas pour autant que la vie est banale dans l'Univers : les planètes sont loin de toujours offrir le nid douillet requis pour qu'elle émerge...
Résumé de l’entretien de Louis D'Hendecourt astrophysicien à l'IAS, au magazine Ciel et Espace |
|
1.
R est un radical variable qui diffère d’un acide aminé à l’autre ; il peut être soit un atome H, soit un groupe alkyl, soit une chaîne comportant des groupes caractéristiques divers.
Ce spectre est-il celui de la leucine ou de l’isoleucine ? Justifier la réponse par au moins deux arguments.
|